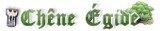-
Résultats de la recherche
-
Deuxième intervention du troisième jour du colloque « Game of Thrones » des Imaginales, dont la thématique générale était : « Game of Thrones : influence et postérité »
« Fin de règnes ? L’après Game of Thrones, pour HBO et pour la Fantasy » par Yann Boudier
Introduction
Yann Boudier commence par définir le concept d’appropriation : il s’agit pour un dominant de se saisir d’un objet culturel appartenant à l’origine à un dominé et d’en tirer un profit, généralement plus élevé, que celui qu’en a tiré le dominé. Il l’illustre en rappelant que si les livres de Martin ont connu un certain succès, il s’agissait d’un succès de niche, qui a généré un profit modeste pour son auteur. En adaptant sa saga, HBO l’a fait sortir du domaine de la sous-culture et l’a adressé à un public plus large, ayant pour conséquence de décupler les profits générés par cette œuvre et d’élargir son public. Game of Thrones a donc permis à la culture populaire de s’approprier la saga Le Trône de Fer.
Objectif de cette communication : construire des exemples pour montrer des figures qui témoignent des évolutions qu’ont pu connaître la télévision et les genres marginaux au fil du temps.
A-A Clash of Kings
David Simon (the Wire, Treme, The Plot against America…) et George R.R. Martin sont deux auteurs qui partagent un certain nombre de caractéristiques, dont un engagement politique assez fort. Ils ont tous les deux cette volonté d’utiliser la fiction pour soutenir un propos politique (Simon habite Baltimore, une ville violente ; Martin a été objecteur de conscience pendant la guerre). Ils écrivent tous les deux en réaction à ce qui s’est fait avant eux, pour écrire quelque chose de neuf, s’éloignant des codes traditionnels. Cette volonté se manifeste par exemple chez David Simon dans la représentation des corps : celui-ci montre à la télévision (notamment sur HBO) des corps pas particulièrement séduisants, alors que le cinéma hollywoodien a plutôt tendance à présenter un idéal de corps parfait. Entre ces deux tendances, la série Game of Thrones préfère renouer avec la tradition hollywoodienne (on se souviendra des scènes de nus ou des scènes d’abdos de Kit Harington, Khal Drogo). Des œuvres qui se sont construites dans l’idée de montrer des corps différents se retrouvent à mettre en avant des corps standardisés. Il y a donc non pas une synthèse du style HBO et du style de George R.R Martin, mais plutôt une juxtaposition : on prend des éléments de la “quality TV” et des éléments qui vont, on l’espère, fonctionner chez Martin, que l’on met côte à côte pour essayer de jouer sur les deux tableaux et de plaire au plus grand nombre au risque de briser la cohérence interne de l’univers. On se retrouve donc dans une même scène avec des sauvageons secondaires sales, boueux, pas spécialement beaux (Orell, Tormund) et des personnages principaux bien propres et séduisants (Jon Snow, Ygritte). L’angle de la caméra accentue d’autant plus ce fossé en cadrant les personnages secondaires de loin et les personnages principaux en gros plan.
Yann Boudier avance que nous sommes actuellement dans un entre-deux, ou il y a une évidence du succès de ces littératures mettant en avant un réalisme boueux, mais pas encore une reconnaissance à part entière. La reconnaissance dont jouit la fantasy à l’heure actuelle est donc essentiellement marchande d’après lui, et se traduit surtout par le succès commercial auprès du grand public des adaptations populaires de certains mondes de l’imaginaire.
Selon Yann Boudier, le moment est particulier pour les fans de fantasy : ceux-ci ont l’impression d’appartenir à une culture encore marginale, qui a besoin de créer des espaces de niches pour exister, pour discuter de leurs passions ; mais dans le même temps, des séries à grands succès comme Game of Thrones au moment de sa diffusion, créent une discussion immédiate qui s’impose partout et des injonctions à regarder les épisodes au plus vite pour éviter les spoilers, pouvoir rejoindre la conversation, et donc augmenter (ou ne pas déprécier) son capital social. Des œuvres comme le Trône de Fer, autrefois apanage d’une sous-culture, d’un public à la marge, se retrouvent à appartenir brutalement au grand public, qui investit les espaces de discussion des fans : tout le monde a un avis, tout le monde peut le donner, ce qui peut donner le sentiment que l’appropriation de cet univers par le grand public entraîne une expropriation pour le public de niche.
De même, la figure du héros mise en avant aujourd’hui évolue, et elle est symptomatique de l’instant plus que de l’évolution du genre. Yann Boudier oppose ainsi la figure de Frodon au Sorceleur : l’un est un simple hobbit, l’autre est un mage-guerrier-mutant. L’un sauve le monde, l’autre (sur certains supports de son histoire, ici le 3e opus de la saga en jeux vidéo) ne cherche qu’à prendre une retraite paisible. Si le premier symbolise donc la figure de la lutte et l’idée que même un petit homme sans pouvoir particulier peut sauver le monde, l’autre offre au contraire une image désabusée où même un personnage d’une grande puissance renonce à influencer le monde et le destin des gens.
Une autre figure classique de la fantasy connaît des distinctions notables : le dragon. Il représente le merveilleux sauvage, magique. Symbole de liberté et de pouvoir dans les classiques, il passe à un idéal de domestication et de soumission dans la culture populaire (Krokmou dans How to train your Dragon).
À travers les images proposées par la pop-culture, Yann Boudier théorise que certaines adaptations (comme Game of Thrones) se refusent à prendre des risques et retirent en conséquence les éléments de leurs univers d’origine qui pourraient ne pas plaire.
Le discours diégétique de la fiction du moment rejoint la fictionnalisation du réel : l’idée qu’il “n’y a pas d’alternative” s’impose dans les fictions. Or le fait même d’avoir des œuvres qui permettent de penser d’autres réels, d’autres possibles, est déjà une forme de résistance qu’il faut défendre à tout prix.
B-A Storm of Streaming
Le succès phénoménal de GoT s’explique d’abord par le moment où la série apparaît. La concurrence des plateformes de VoD n’étant pas lors de sa sortie en 2011 ce qu’elle est aujourd’hui, la place médiatique était disponible.
Au contraire, les Hulu, Disney+ ou autre Amazon Prime semblent désormais toutes vouloir mettre en avant leurs séries de fiction, souvent basées sur les mêmes dominantes de noirceur et cynisme qui pourraient à terme lasser les spectateurs.
Yann Boudier met également en avant que la multiplicité des plateformes risque de relancer le téléchargement illégal qui avait décliné ces dernières années, et donc engendrer une baisse de moyens pour les productions de l’imaginaire.
Il dénonce enfin l’appropriation du contenu par les dirigeants de ces chaînes à la recherche d’un profit toujours plus grand, appâtés par le succès de GoT. En faisant cela, ils imposent leurs modèles au détriment de l’originalité de la création.
Des exemples existent cependant pour éviter l’écueil de la répétition avec notamment Mrs Maisel qui utilise des éléments de comédie musicale ou Harmon Quest avec le jeu de rôle.
Conclusion
Finalement, ce qui compte dans la défense des genres dit mineurs est moins de réussir à les faire atteindre des sommets que de permettre à celles des œuvres qui n’ont pas encore rencontré de succès d’avoir leur chance.
Même si la tâche paraît ardue, il faut « imaginer Sisyphe heureux », c’est-à-dire que le chemin qui mène à ce but importe, quand bien même le résultat n’est pas assuré. Pour conclure, Yann Boudier cite un célèbre barbu à chapeau pointu affirmant que « même la plus petite personne peut changer le cours de l’histoire ».
Après un Master de Littérature Comparée (sous la direction de F. Lecercle, Paris 4) interrogeant le lien entre genre et légitimité dans le cas Game of Thrones, Yann Boudier est actuellement en thèse et travaille sur la plus large question de l’appropriation systémique des cultures marginales, et sur le rôle que l’adaptation peut avoir à jouer dans ce processus.
-
Ce sujet a été modifié le il y a 5 années et 3 mois par
 Lapin rouge.
Lapin rouge.
--Ezor--
Spoiler:Deuxième intervention du deuxième jour du colloque « Game of Thrones » des Imaginales, dont la thématique générale était : « le réalisme historique de Game of Thrones et du Trône de Fer »
*
« La vérité est dans les archives : l’utilisation du matériau historique dans Game of Thrones » – par Florian Besson
[Attention ! Cette communication parle essentiellement de la série télévisée Game of Thrones, et parle notamment de sa fin !]
C’est un topos classique en fantasy : un personnage qui se plonge dans de vieux grimoires (souvent poussiéreux) pour découvrir une vérité sur l’univers/essentielle à l’intrigue. On a le cas de Gandalf à Minas Tirith, d’Harry Potter à Poudlard, etc…. Des recherches qui au passage semblent bien facile à l’historien qui a l’habitude de fréquenter un réel dépôt d’archive, mais qui permettent de condenser l’intrigue.
GoT propose de nombreuses scènes se déroulant dans des bibliothèques. La série pose la question de l’utilité de l’histoire à la fois comme récit du passé ainsi que comme discipline historique étudiant ce passé.
Qui utilise l’histoire ?
En particulier pour les livres d’histoire :
*Ned Stark qui découvre le secret de l’inceste Lannister dans la Généalogie des Hommes Illustres.
*Tyrion qui cherche désespérément des éléments pour se préparer au siège de la Néra (saison 2).
*Sam dans les archives de Châteaunoir, puis à la Citadelle.
Florian Besson note aussi qu’il y a d’autres personnages associés à l’écrit – notamment Tywin, très associé aux lettres – mais il se concentre sur les récits historiques.
Les trois personnages cités sont ceux porteurs des valeurs les plus modernes dans ce monde, face à la brutalité présentée « médiévale » des autres personnages. Une valeur entre renforcée par le fait qu’ils consultent des livres.
La phrase de Tyrion (« un esprit a autant besoin de livre qu’une épée d’une pierre a aiguisé ») illustre une forme de clivage : d’un côté le héros guerrier a l’épée, de l’autre l’esprit érudit qui s’avère, au fil de la série, finalement plus puissant. Ne peut-on pas voir l’opposition classique qu’on retrouve dans les JdR entre le guerrier (force, courage) et le magicien (intelligence, ruse) ? Et Sam comme un petit clin d’oeil ironique et amusé au cliché du geek ?A quoi sert l’histoire ?
A découvrir la vérité (intradiégétiquement). Les scènes qui se déroulent dans les bibliothèques ont souvent un rapport avec le passé. L’histoire est utilitaire dans la série. Livres et archives ont une autorité incontestée (cf. quand Sam découvre l’identité réelle de Jon dans un bouquin et qu’il prend pour argent comptant direct).
Du coup c’est assez peu étonnant que Brandon Stark – incarnation de l’histoire – finisse par devenir le roi.
GoT couronne-t-il un roi historien et met-il en valeur le récit historique ?
Florian Besson explique que c’est plus complexe, car la série ne cesse de mettre en doute la valeur de l’histoire. Ainsi, Sam à la fin de la série présente un livre intitulé A Song of Ice and Fire, qui est en fait une mise en abyme du récit – une technique qui permet d’inclure encore plus le spectateur dans le récit. Une mise en abyme qui est suggérée par le générique : les anneaux que l’on y voit (avec des morceaux de l’histoire du monde) sont celles des sphères que contemple Sam à la Citadelle. Lorsque Sam présente à Tyrion le livre, il lui dit qu’il n’apparaît pas, malgré le rôle essentiel de Tyrion. Cela interroge sur la fiabilité de l’œuvre. C’est certes une plaisanterie, pour faire rire aux dépends de Tyrion. Mais on peut aussi penser à une autre analyse : la série souligne combien l’histoire est politique, et qu’elle n’a pas de vérité propre. Une chose que l’on voit avant en fait : dans la saison 1, Cersei dit clairement à Joffrey que, lui roi, pourra faire dire à l’histoire ce qu’il veut. Et d’ailleurs une statue plus tard le met en scène en train de terrasser un loup. On peut également penser au dialogue entre Varys et Littlefinger devant le Trône de Fer où ils abordent cette question.
La fantasy médiévaliste a toujours eu un rapport fort à la discipline historique. Depuis une vingtaine d’années, les historiens ont travaillé sur les conditions d’élaboration des textes historiques et ont montré la difficulté d’établir une vérité factuelle (Patrick Boucheron dit comme Littlefinger, que les Empires se créent sur des histoires qu’ils se racontent à eux-mêmes).
Mais il n’y a pas que ça : ce livre donné à Tyrion s’inscrit dans une tendance récente qui vise à mettre en scène une histoire secrète, alternative. C’est autour de ce concept que se construisent certains romans (Mary Gentle, Fabien Cerutti). L’histoire officielle, qu’on connait, est fausse car sciemment déformée. Toute l’histoire qu’on nous raconte depuis le début sur Lyanna et Rhaegar par exemple est fausse : elle n’a pas été enlevée et violée. Depuis la première page, on nous ment. Si Florian Besson reconnait l’intérêt narratif d’un tel motif, il pense qu’il y a aussi une lecture politique à faire derrière ce motif. L’idée selon laquelle l’histoire est un mensonge déformée par les dominants ou construite par une institution, est le fonds de commerce de livres de « pseudo-historiens » qui s’en prennent aux historiens qui cacheraient la « vraie histoire ». L’image du « seul contre tous » est mise en scène dans la série dans la scène où Sam essaye de convaincre les archimestres de se mobiliser contre les Marcheurs Blancs. Mais les archimestres se tiennent à la méthode historique (ils demandent d’autres sources). Ce faisant ils se placent dans le « faux » (le spectateur lui sait que Sam a raison)
Conclusion
GoT, un modèle pour la fantasy ? négatif : la série n’innove pas et reproduit le trope des bibliothèques qui renferme la révélation finale. Mais la série tient aussi un discours ambivalent sur la valeur réelle de l’histoire comme discipline. De façon plus générale, c’est un choix narratif fait par Martin pour son œuvre qui choisit d’éclater la narration entre plusieurs personnages. Au lecteur de construire sa vérité. Martin est d’ailleurs à remettre dans son contexte historique troublé (guerre du Vietnam, Watergate, etc..) et il émet lui-même des doutes sur la notion de vérité historique.
Le fait que la fantasy intègre ces éléments lié au renouvellement historiographique n’est pas forcément une bonne chose selon Florian Besson, dans un contexte actuel où on ne cesse de dire que l’histoire comme science ne vaut pas grand-chose.
Mais série est au final et comme toujours plus complexe : Florian Besson finit sur la toute dernière scène de Brienne que l’on voit compléter la page du Livre Blanc sur Jaime, sans dire de mensonge : il n’y a pas de manipulation derrière tous les écrits historiques.—
Florian Besson : Historien médiéviste, engagé dans la diffusion de la recherche, il travaille depuis plusieurs années sur les médiévalismes contemporains, en particulier sur les réseaux sociaux et dans la fantasy. Il a codirigé un ouvrage sur Kaamelott, participé à la rédaction du Dictionnaire de la fantasy dirigé par Anne Besson et, plus récemment, à celle du site internet de la BnF consacré à la fantasy. Avec Justine Breton, il a écrit un ouvrage consacré à Game of Thrones (Une histoire de feu et de sang. Le Moyen Âge de Game of Thrones), à paraître.#hihihi
Co-autrice : "Les Mystères du Trône de Fer II - La clarté de l'histoire, la brume des légendes" (inspirations historiques de George R.R. Martin)
Première Prêtresse de Saint Maekar le Grand (© Chat Noir)Première intervention du premier jour du colloque « Game of Thrones » des Imaginales, dont la thématique générale était : « Game of Thrones, nouveau modèle pour la Fantasy? »
Thierry Soulard « A Song of Ice and Fire, un monde secondaire polysémique qui se joue des prophéties »
[Série – romans]
Thierry Soulard introduit son propos en rappelant ce qu’est une prophétie en fantasy, d’après la définition du dictionnaire de la fantasy (Editions Vendemiaires, sous la direction d’Anne Besson). Elle est soit un guide pour l’action future du héros, révélant sa destinée ou annonçant son avènement ; soit une annonce mystérieuse, annonçant des événements futurs.
La prophétie est un cliché usuel de la fantaisie : la plupart du temps, il n’y en a qu’une qui joue un rôle central au sein d’une saga littéraire. Dans <i>Le Trône de Fer</i>, Martin se sert du cliché de la prophétie et l’exploite : il n’y a pas une prophétie unique, il y a plusieurs éléments prophétiques, qu’on retrouve dans des rêves, dans des visions, dans des prédictions. Toute la saga, tous les livres se rapportant à l’univers du<i> Trône de Fer </i>sont parcourus d’une surabondance de phénomènes prophétiques.
Thierry Soulard range ces phénomènes prophétiques en trois catégories :
- Les phénomènes explicitement magiques : ceux qui annoncent un futur qui se réalise (exemple : rêves verts de Jojen).
- Les prophéties semi-réalistes : celles qui sont entre le rêve et la prophétie surnaturelle (exemples : rêves pas encore réalisés de Jaime, Tyrion ou Jon). Celles-ci peuvent donc être interprétées, soit comme la manifestation de l’inconscient du personnage, soit comme de véritables prophéties pour l’avenir de la saga.
- Les prophéties à utilisation politique : celles-ci apparaissent à un moment opportun et sont généralement utilisées dans un but essentiellement politique (exemple : prophétie de Mélisandre autour d’Azor Ahai) Il s’agit généralement de prédire l’arrivée d’un sauveur, afin de justifier les actions de celui-ci. Il peut aussi s’agir de paroles permettant d’impressionner un autre personnage ou de le persuader d’un avenir inéluctable.
Thierry Soulard tisse un lien entre ces dernières prophéties et l’histoire. Il explore certaines prophéties historiques du Moyen Âge, qui annonçaient l’avènement d’élus. Au cours du Moyen Âge, plusieurs interprétations de prophéties sont proposées :
- au temps des croisades, apparaît la prophétie du prêtre Jean, qui annonçait l’arrivée d’un puissant roi chrétien qui viendrait en aide aux Croisés. A l’époque de Marco Polo, un chef de guerre mongol est identifié comme ce fameux prêtre Jean. Plus tard, on croit que l’Éthiopie est le royaume du prêtre Jean.
- La prophétie de la pucelle de Lorraine existait avant Jeanne d’Arc ; aussi quand celle-ci apparaît, elle est accueillie favorablement.
Les prophéties sont utilisées de manière essentiellement politique à l’époque du Moyen Âge, car elles ont une grande influence. Henri VII (Tudor) d’Angleterre finit par les interdire, car elles deviennent dangereuses pour lui.
Certaines de ces prophéties historiques ont été reprises dans la littérature, notamment par Shakespeare, qui va mettre en évidence certains jeux de mots, qui font tout l’intérêt de ces prophéties, car leur réalisation n’est pas littérale, mais plutôt symbolique :
- Henri IV devait mourir à Jérusalem ; il meurt finalement dans la chambre de Jérusalem de l’Abbaye de Westminster. (à noter : il s’y rend de son plein gré, comme une acceptation de la prophétie.)
- Le duc de Sommerset devait éviter un château ; il meurt dans une auberge portant comme enseigne un château.
- Macbeth ne sera renversé que lorsque la forêt avancera sur son château ; une armée, camouflée par des branchages, se rapproche finalement de son château avant de l’attaquer. (Cette image est reprise par GRRM dans ADWD lors de la bataille de Motte-la-Forêt)
GRRM dit lui-même dans ses interviews que les prophéties sont trompeuses et qu’il faut chercher les mots ambigus, trompeurs. Il le fait également dire par plusieurs personnages dans la saga (notamment Tyrion), ce qui renseigne le lecteur sur la véritable nature des prophéties de GRRM.
Dans les livres, GRRM utilise des prophéties qui se réalisent de bien des manières différentes (sur un jeu de mot, de manière littérale, de manière symbolique ou en trompe-l’œil). Il arrive même qu’elles se réalisent plusieurs fois et qu’on puisse donc les interpréter de plusieurs manières différentes, comme lorsque Stannis voit un roi brûlé par sa propre couronne de feu : lui-même l’interprète comme une métaphore de sa condition, un roi que son propre pouvoir consume. Le lecteur peut y voir une représentation littérale du destin de Viserys III lors de la première intégrale. Une seule et même image peut donc tour à tour être symbolique ou littérale, comme lorsque Jojen Reed rêve que Bran et Rickon se font écorcher par « Schlingue » et qu’ils se retrouvent dans le caveau familial au milieu des rois de pierre : en définitive, les enfants qui sont tués par « Schlingue » sont de faux Bran et Rickon, les vrais s’étant réfugiés dans les cryptes de Winterfell.
Thierry Soulard revient ensuite à ce qui fait le cœur de son analyse du TdF : le monde de GRRM est fait de mots, et les prophéties aussi. Les mots ont plusieurs sens, et un seul mot, utilisé dans une prophétie, peut donc renvoyer à plusieurs interprétations. Ainsi, dans le TdF, un corbeau peut désigner un simple animal, ou un frère juré de la Garde de Nuit, ou Freuxsanglant, ou Euron Œil-de-Choucas, ou les Nerbosc … Balerion est le nom d’un dieu valyrien, d’un dragon, d’un chat, d’un bâtard Targaryen ou d’un bâteau.
Grâce aux mots et à leur polysémie extra et intradiégétique, Martin élargit le spectre des possibilités d’interprétations de ses prophéties. D’après saint Jérôme, parlant de l’Apocalypse : « L’apocalypse contient autant de mystères que de mots. […] En chacun des mots se cachent des sens multiples. » Thierry Soulard tisse donc un parallèle entre les deux œuvres, expliquant que les prophéties du Trône de Fer peuvent elles aussi être interprétées et donner lieu à de multiples réalisations, soit littérales, soit symboliques, soit magiques.
En conclusion, Thierry Soulard pose la question : quelle sera la fin de la saga ? Évoquant le destin de Sandor Clegane des livres, il explique qu’à l’heure actuelle, les fans peuvent envisager soit qu’il est mort, soit qu’il est toujours en vie et en pleine rédemption de ses péchés. Thierry Soulard partage son souhait que la fin de GRRM laissera, elle-aussi, place à l’interprétation : il espère que telle les prophéties de cet univers, la fin de la saga restera ouverte sur de multiples possibilités d’interprétation.
——-
Thierry Soulard : journaliste indépendant, auteur de nouvelles et de romans, membre de La Garde de Nuit. Il a publié « Les mystères de Trône de fer tome 1 : Les mots sont du vent » (éd. Pygmalion, 2019). Il a co-écrit « Les mystères de Trône de fer tome 2 : La clarté de l’histoire, le brouillard des légendes » avec Aurélie Paci (éd. Pygmalion, à paraître.. un jour ^^’).
"Si l'enfer est éternel, le paradis est un leurre !"
-
Ce sujet a été modifié le il y a 5 années et 3 mois par